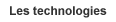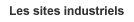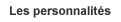Nom de l'entreprise : Ateliers Jean Prouvé
Historique : Après son service militaire, Jean Prouvé ouvre son premier atelier en janvier 1924, au 33 rue du Général Custine à Nancy. S’équipant de matériel moderne, l’atelier connaît une croissance rapide. Sept ans plus tard, malgré la crise économique qui touche le secteur du bâtiment, Jean Prouvé s’installe en janvier 1931 au 50 rue des Jardiniers à Nancy et crée la société anonyme les « Ateliers Jean Prouvé », au capital de 500 000 F.
Progressivement, il s’éloigne du travail à la forge pour se tourner vers ce qui devient sa technique de prédilection : la tôle pliée. Les ateliers font l’acquisition d’un outillage performant pour plier le métal et comptent, dès le début des années 1930, une quarantaine de « compagnons ». Cette croissance n’est cependant pas sans risque. Les bénéfices sont modestes et les investissements continus engendrent des difficultés de trésorerie. La notoriété acquise par les Ateliers Jean Prouvé permet à l’entreprise d’envisager des augmentations de capital, au détriment du contrôle exercé par le fondateur.
Durant la Seconde Guerre mondiale, malgré le manque de matières premières et le personnel réquisitionné, Prouvé parvient à maintenir l’activité de ses ateliers tout en refusant de collaborer avec l’occupant. Le premier rapprochement de Jean Prouvé avec l’industrie de l’aluminium s’effectue par l’intermédiaire d’une commande. S’appuyant sur un brevet déposé en 1938 suite à un concours pour le ministère de l’Air, Prouvé conçoit en 1939 des pavillons démontables pour le compte de la Société centrale des alliages légers (SCAL). La SCAL est détenue en majorité par la Société du duralumin, elle-même liée à la Compagnie des produits chimiques et électrométallurgiques Alais, Froges et Camargue (AFC, future Pechiney) et à L’Aluminium français (AF), société de vente et de promotion du métal léger. Installées à Issoire, ces constructions constituent la première mise en œuvre du système à portique qui connaîtra de nombreux développements dans l’œuvre du constructeur nancéien.
A la Libération, les actes de Résistance de Jean Prouvé lui valent d’être nommé maire de Nancy. La production des ateliers s’est alors étendue des meubles à la réalisation de bâtiments métalliques et l’entreprise décide de s’installer dans de nouveaux locaux, plus vastes, sur le site de Maxéville (ancienne cimenterie acquise en 1946).
La Reconstruction offre aux Ateliers Jean Prouvé la possibilité d’envisager la production de maisons usinées en grande série. C’est dans ce contexte que l’AF considère un rapprochement avec l’entreprise.
S’appuyant sur l’analyse du marché américain où la construction représente le principal débouché de la production d’alliages légers, l’AF a pour ambition de développer ce secteur. Toujours en prise à des difficultés de trésorerie, Jean Prouvé envisage en 1949 une nouvelle augmentation de capital. L’AF réactive une filiale créée en 1931, Studal (Le Studio des alliages légers puis Société technique pour l’utilisation des alliages légers) qui prend une participation de 17% au capital de l’entreprise. Studal compte alors parmi ses actionnaires les principaux acteurs de la transformation de métal léger en France. En échange d’une exclusivité sur les ventes et d’une commission de 6%, l’AF s’engage à soutenir l’effort de développement des Ateliers Jean Prouvé.
Les difficultés financières se poursuivent et en 1951, des commandes d’ampleur très variables forcent la production à s’adapter sans cesse. La trésorerie fonctionne par à-coups.
En 1951, les Ateliers Jean Prouvé procèdent à une nouvelle augmentation du capital. L’AF porte sa part à 5 millions de francs, et Cegédur (Compagnie générale du duralumin et du cuivre) entre pour 6 millions dans le capital, le 8 octobre 1951. En 1952, le capital augmente encore et atteint 125 millions, dont 64 détenus par les entreprises de transformation de l’aluminium, dont l’optique est très différente de celle de Jean Prouvé.
Le 23 avril 1952, M. Chaudron, ingénieur de la Cegédur, prend la direction du site de Maxéville. Jean Prouvé s’oppose à la direction prise par l’entreprise. À la suite du licenciement d’une partie des salariés, il démissionne lors de l’Assemblée générale ordinaire du 30 juin 1953, marquant son opposition vis-à-vis des nouvelles orientations prises par la direction. Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 1956, les statuts sont modifiés et la dénomination de la société devient « Ateliers de construction préfabriquée de Maxéville » (ACPM), ceci afin de permettre à Jean Prouvé de retrouver une autonomie totale vis-à-vis de la société.
Sources principales consultées :
CHERRUET, Sébastien. L'aluminium dans l'œuvre de Jean Prouvé, jalons et sources. Cahiers d'histoire de l'aluminium, 2011/1-2 (n° 46-47), p. 50-67. DOI : 10.3917/cha.046.0050. URL : https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-histoire-de-l-aluminium-2011-1-page-50.htm
Fonds Rhenalu, boite 9400694 : dossiers des Assemblées générales tenues entre le 6 juin 1951 et le 26 novembre 1957.